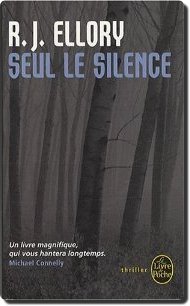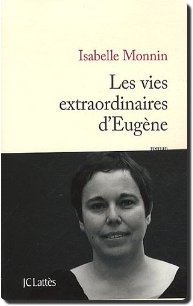Me voici de retour après plusieurs mois (!!!) d’absence de la blogosphère. Mine de rien, le temps passe vite et il faut que je me remette tout doucement à flot. Une des raisons de ma « disparition » étant un futur déménagement, il me reste encore beaucoup de choses à faire et je risque donc d’avoir une présence plutôt aléatoire sur ce blog. Mais qu’importe, je suis heureuse et pour fêter ça, mon premier article de l’année sera sur Beach Music, un véritable coup de cœur. 🙂 Et maintenant, je vais pouvoir aller me promener sur vos blogs trop longtemps délaissés.
 4ème de couverture : Installé à Rome avec sa fille Leah, Jack McCall s’est juré de ne plus revenir à Waterford (Caroline-du-Sud), que le suicide de sa femme Shylla et le procès intenté contre lui par sa belle famille l’ont poussé à quitter. Un télégramme lui annonçant l’agonie de sa mère va cependant le faire changer d’avis.
4ème de couverture : Installé à Rome avec sa fille Leah, Jack McCall s’est juré de ne plus revenir à Waterford (Caroline-du-Sud), que le suicide de sa femme Shylla et le procès intenté contre lui par sa belle famille l’ont poussé à quitter. Un télégramme lui annonçant l’agonie de sa mère va cependant le faire changer d’avis.
Dès son arrivée, les souvenirs affluent… Des souvenirs où les drames de chacun renvoient aux commotions de l’Histoire, de l’Holocauste à la guerre du Viêtnam, à tout un passé chaotique avec lequel Jack devra se réconcilier.
Les forêts et les marécages de Caroline-du-Sud, les plages et les parties de pêche de l’enfance entourent d’une poésie sauvage cette saga aux mille ramifications.
Un grand merci à Manu qui m’a offert ce livre (elle savait ce qu’elle faisait! :-)) et un immense merci à Pat CONROY qui pour la seconde fois, m’émerveille et m’éblouit (Pat, si tu me lis… ^^).
En prenant comme point central de son roman Jack McCall, un sudiste exilé en Italie après le suicide de sa femme et en suivant comme fil conducteur son retour en Caroline du Sud à l’annonce de la leucémie de sa mère, Pat CONROY entraine son lecteur dans un récit qui aborde tout à la fois l’Holocauste, la guerre du Vietnam, les passés troubles, les relations parents-enfants, l’amour, l’amitié, la réussite ou la recherche du bonheur et qui se déroule dans des décors aussi somptueux ou effrayants que Venise, l’Europe pendant la Seconde Guerre Mondiale et surtout le Sud, à la fois attirant et repoussant. En plus d’être formaté par l’éducation reçue, chaque personnage porte le poids du passé de ses parents et ce retour au pays va être l’occasion pour Jack de faire le point sur son propre passé, de l’affronter et non plus l’éviter ou l’ignorer, et cela lui permettra de ne pas reproduire le même schéma avec sa fille.
Les personnages créés par Pat CONROY sont nombreux et tous aussi complexes les uns que les autres et cela donne lieu à de multiples flashbacks éclairant certains des aspects les moins glorieux de notre histoire.
La structure narrative, par laquelle les souvenirs affluent lentement et progressivement sans pour autant laisser de temps mort, qui nous montre Jack évoluer doucement et ne laisse aucun personnage dans l’ombre, ainsi que le style somptueux et florissant m’ont énormément touchée.
J’ai été émue en particulier par l’amour/haine voué par Jordan à son père et qui, pour lui plus que pour tout autre, a décidé du reste de sa vie.
J’ai trouvé dans ces pages une infinie splendeur et le soleil du Sud qui m’a un peu réchauffée par cet hiver glacial. Superbe !